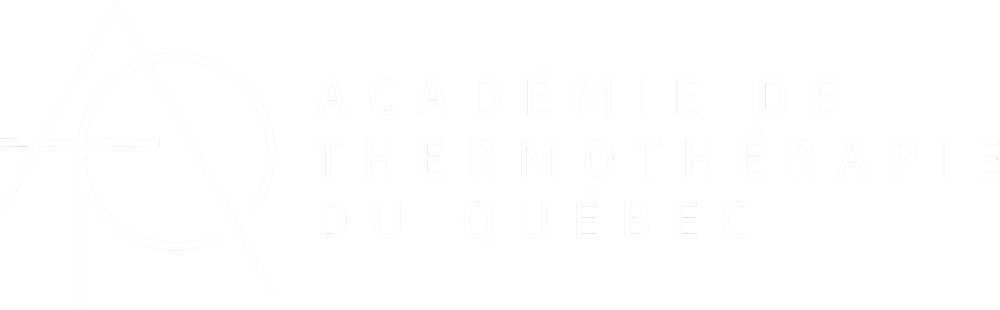Une pratique en plein essor au Québec
Depuis quelques années, les cold plunges (bains froids) connaissent une popularité fulgurante. On les retrouve désormais dans les spas, les gyms, les événements sportifs et même dans les cours arrière de citoyens qui s’installent leurs propres bassins. Partout au Québec, des milliers de personnes s’immergent chaque semaine dans l’eau glacée, séduites par les promesses de bien-être, de performance et de dépassement de soi.
Un vide réglementaire préoccupant
Mais derrière cette image inspirante se cache une réalité inquiétante : au Québec, il n’existe aucun encadrement officiel de la pratique. Contrairement aux piscines publiques ou aux saunas, les bassins froids ne sont soumis à aucune norme de sécurité, aucune législation et aucune exigence claire. Tout repose donc sur la responsabilité individuelle des pratiquants et la bonne volonté des exploitants.
Résultat : les protocoles varient énormément d’un endroit à l’autre, et la sécurité n’est pas toujours garantie.
Du personnel souvent non formé
Un autre problème majeur réside dans le manque de formation du personnel dans plusieurs établissements qui offrent des cold plunges. Peu ou pas de connaissances sur les contre-indications médicales.
Une absence de protocoles clairs sur la gestion d’un malaise ou d’un choc thermique.
Très peu de préparation en secourisme adapté aux expositions extrêmes.
Ainsi, des employés se retrouvent à superviser une pratique potentiellement risquée sans les outils nécessaires pour intervenir adéquatement en cas de complication.
L’exemple ailleurs : l’Ontario et les recommandations de santé publique
En Ontario, Public Health Ontario a déjà émis des notions précises :
Les risques d’hypothermie ou de perte de conscience liés à une immersion trop longue ou trop intense.
La nécessité de protocoles clairs (durée d’exposition, température minimale, surveillance et premiers soins disponibles).
Ces notions visent à encadrer la pratique avant qu’un accident ne survienne.
Au Québec : attendre une tragédie pour agir ?
L’histoire démontre souvent que les législations arrivent après une fatalité. Doit-on attendre qu’un incident majeur se produise ici pour qu’un cadre soit établi ?
Avec l’essor rapide du cold plunge, le risque n’est pas théorique : une syncope, une arythmie cardiaque ou un malaise pourraient avoir de graves conséquences si l’encadrement fait défaut et si le personnel n’est pas préparé à intervenir.
Recommandations concrètes de l’ATHEQ
Pour assurer une pratique sécuritaire et durable du cold plunge au Québec, nous proposons :
🟢 Former le personnel encadrant
Offrir des formations spécifiques en thermothérapie, incluant la gestion des contre-indications, les signes d’hypothermie, et les protocoles d’intervention en cas de malaise.
🟢 Établir des protocoles standardisés
Définir des balises claires : durée maximale d’exposition, températures minimales/moyennes acceptées, procédures d’entrée et de sortie sécuritaires.
🟢 Renforcer la supervision des installations
Exiger la présence d’un membre du personnel formé lors de l’utilisation des bassins froids.
Prévoir un équipement de sauvetage et un accès rapide à des premiers soins adaptés.
👉 Ces mesures simples permettraient de structurer la pratique sans la freiner, en protégeant autant les usagers que les exploitants.
La position de l’ATHEQ
À l’Académie de thermothérapie du Québec (ATHEQ), nous croyons que la popularité de l’immersion froide doit s’accompagner d’une approche responsable.
C’est pourquoi nous avons déjà approché le gouvernement du Québec afin de collaborer à la mise en place d’un encadrement sécuritaire et durable de la pratique.
Notre objectif n’est pas de restreindre l’accès, mais de protéger le public, soutenir les exploitants et assurer une croissance saine de cette discipline.
Conclusion : prévenir plutôt que réagir
Le cold plunge n’est pas une simple tendance passagère : il s’agit d’une pratique qui s’installe durablement dans nos habitudes de santé et de bien-être. Sans encadrement ni formation adéquate des équipes, le Québec prend du retard et des risques.
Il est temps d’anticiper, d’éduquer et de structurer, avant qu’un premier accident grave ne survienne.